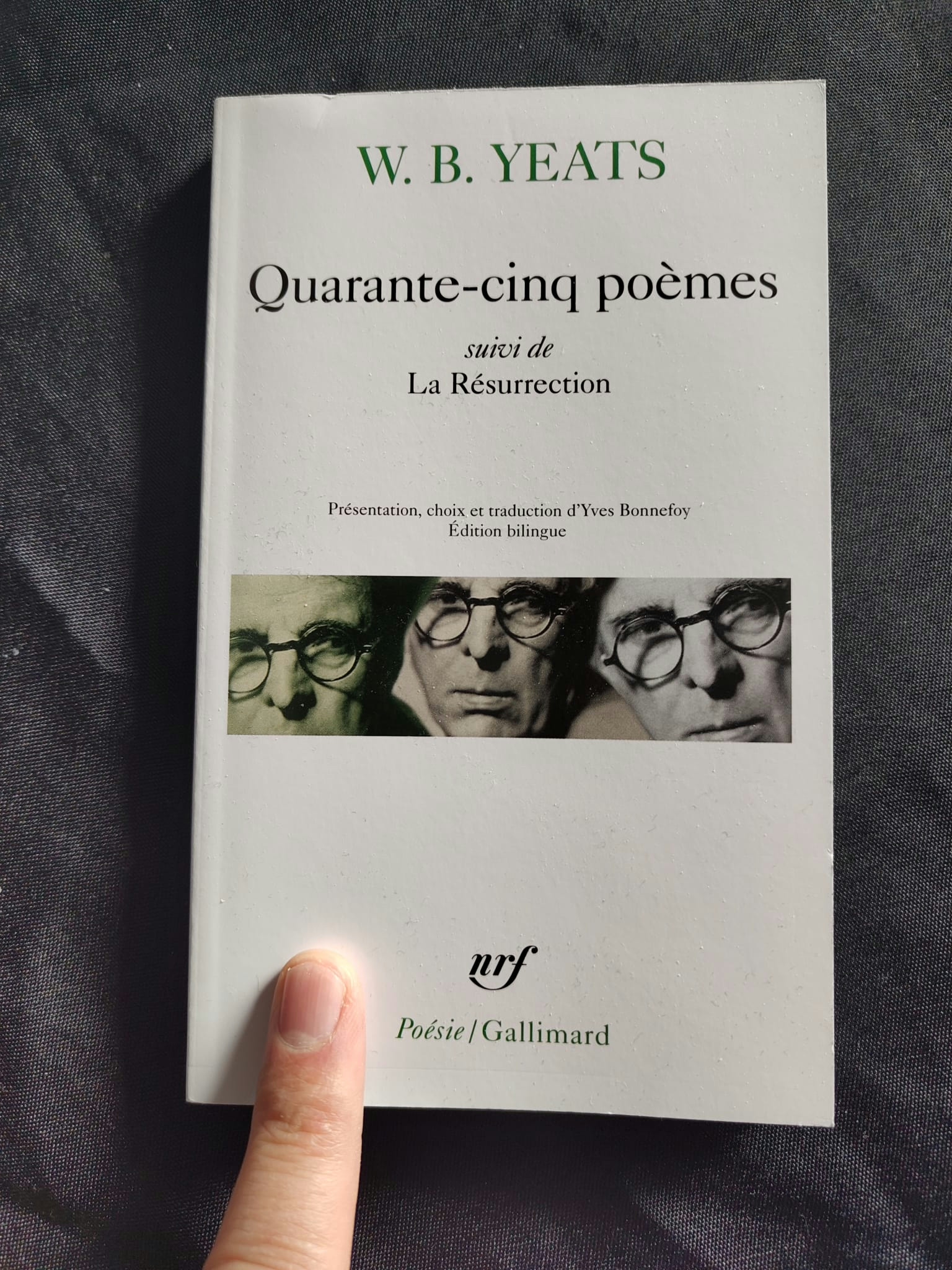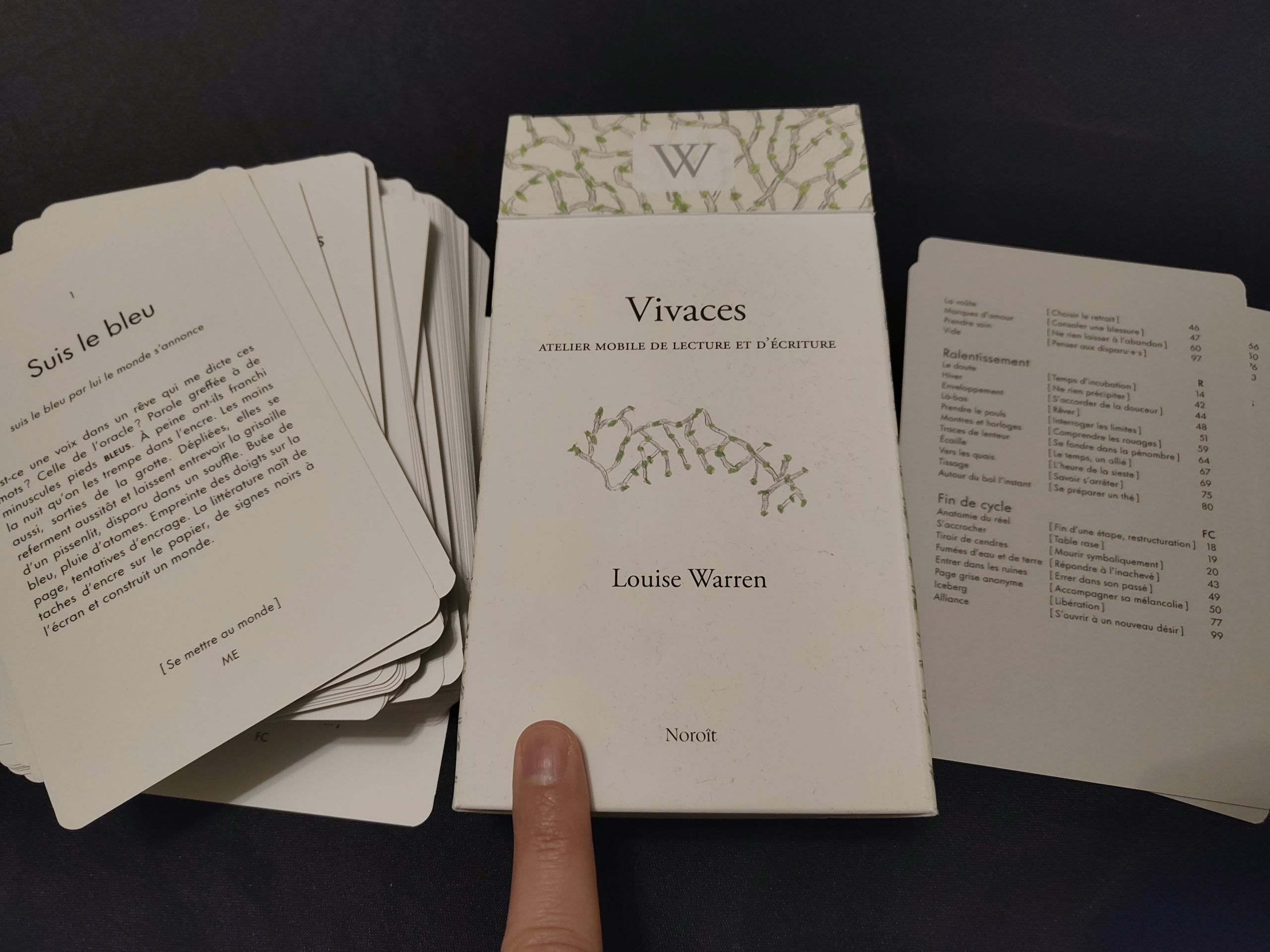Comment une adolescente de treize ans trouve-t-elle les mots pour dialoguer avec l’invisible ? Quelle nécessité intérieure pousse une voix à s’élever ainsi, entre candeur mystique et lucidité fulgurante ? Le Livre des anges suivi de La Nuit spirituelle et de Carnet d’une allumeuse, publié dans la prestigieuse collection Poésie/Gallimard avec une préface de Christian Bobin, rassemble trois œuvres majeures de Lydie Dattas qui tracent, sur près de cinquante ans, l’itinéraire d’une des plus grandes voix poétiques féminines de notre temps. Écrit pour l’essentiel entre treize et vingt ans, Le Livre des anges rayonne d’une pureté qui défie les années. Ce n’est pas une poésie d’adolescente, c’est une parole d’éternité prononcée par une jeune fille qui semble avoir déjà traversé tous les mystères. Nous voici face à un texte rare, qui fait de la beauté une religion et du malheur un maître de sagesse.
Portrait d’une contemplative au bord du monde
La première rencontre avec ce livre s’impose comme une évidence visuelle. Sur fond crème, le nom de l’auteur s’inscrit en lettres rouges capitales – LYDIE DATTAS – comme une signature de feu qui annonce la brûlure intérieure du texte. Le titre principal, Le Livre des anges, s’affiche en noir élégant, suivi des deux autres recueils qui composent ce volume : La Nuit spirituelle et Carnet d’une allumeuse. Cette trilogie trouve son unité dans une photographie centrale qui capte l’essence même de l’œuvre.
Une jeune femme de profil, vêtue de blanc immaculé, se tient face à un horizon marin teinté de rose et de rouge, couleurs du crépuscule ou de l’aube. Son visage concentré, son regard tourné vers l’infini, sa posture recueillie évoquent la figure de la contemplative. Le blanc de sa tunique répond au blanc du livre, tandis que les teintes rosées du ciel dialoguent avec le rouge du nom de l’auteur. Cette chromie, blanc, rouge, rose, n’est pas innocente. Elle évoque la pureté du lys, le sang du sacrifice, la chair de la rose. Trois couleurs qui reviennent obsessionnellement dans les poèmes et qui symbolisent les trois âges de la conscience féminine explorés dans ce volume.
La jeune femme photographiée semble habitée par une présence invisible. Elle ne pose pas, elle écoute. Son profil rappelle celui des madones italiennes, mais dépouillé de tout apparat religieux. L’image suggère une solitude peuplée d’anges, une intériorité si riche qu’elle déborde sur le monde extérieur. Le paysage marin, vaste et ouvert, devient le théâtre d’un dialogue silencieux avec l’absolu. Cette couverture réussit ce tour de force, donner à voir l’invisible conversation qu’entretient toute l’œuvre. Elle promet un livre hors du temps, une parole venue de ces régions où la beauté et la souffrance se confondent.
La foudroyée qui n’a cessé d’écrire la lumière
Née le 19 mars 1949 à Paris, Lydie Dattas grandit dans un environnement artistique exceptionnel. Son père, Jean Dattas, est compositeur et organiste titulaire de Notre-Dame de Paris ; sa mère est actrice de théâtre. L’enfance baigne ainsi dans les sons d’orgue qui résonnent sous les voûtes gothiques et dans le verbe déclamé sur les planches. Cette double filiation, musicale et dramatique, marquera profondément une écriture où chaque vers cherche sa mélodie propre et où chaque poème déploie une intensité théâtrale.
À six ans, la famille s’exile en Angleterre. Lydie poursuit ses études au Lycée français de Londres, institution qu’elle considérera plus tard comme une prison. C’est dans cet entre-deux géographique et linguistique qu’elle commence à écrire ses premiers poèmes, à l’âge de treize ans. Très tôt, l’écriture s’impose comme nécessité vitale, comme seul espace de liberté véritable. À seize ans, quelques-uns de ses textes paraissent dans la revue Rougerie. À vingt ans, elle publie son premier recueil, Noone, au Mercure de France, après que ses poèmes sont tombés entre les mains du poète Jean Grosjean, lecteur chez Gallimard. Une correspondance s’engage entre eux, qui aboutira à la forme définitive du Livre des anges.
En 1972, Lydie épouse Alexandre Bouglione, dompteur de fauves appartenant à la célèbre dynastie gitane des Bouglione. Ce mariage, qui durera vingt ans, l’inscrit dans l’univers fascinant du cirque. Elle vit à Pigalle, dans l’immeuble « Bouglione » construit à l’emplacement de l’ancien cirque Médrano. En 1977, Jean Genet s’installe dans le même immeuble. Une amitié se noue, orageuse et féconde. Après une dispute où Genet la bannit en déclarant détester les femmes, Lydie écrit La Nuit spirituelle, texte d’une beauté foudroyante qui pose la question de la malédiction spirituelle féminine. Genet, en lisant le manuscrit, revient vers elle et lui adresse une lettre stupéfiante d’admiration : « Pardonnez-moi de vous dire cela aussi brutalement, mais ce que vous avez fait est très, très beau. » Il compare sa langue à celle de Baudelaire et Nerval. Plus tard, Lydie écrira sur lui La chaste vie de Jean Genet (2006), portrait intime d’un auteur vieillissant que le public ne connaissait pas.
Lydie Dattas correspond également avec l’écrivain allemand Ernst Jünger, qui mentionne La Nuit spirituelle dans le dernier tome de son Journal. En 1994, elle fonde avec Alexandre Bouglione le cirque Lydia Bouglione, devenu cirque Romanès, parrainé par le violoniste Yehudi Menuhin. Après son divorce en 2000, elle rencontre Christian Bobin. Une relation profonde s’établit entre les deux poètes, qui aboutit à un mariage et une compagnie de vingt-deux ans, jusqu’à la mort de Bobin en novembre 2022.
L’œuvre de Lydie Dattas se nourrit de ces rencontres exceptionnelles et de ces expériences limites. Fille d’organiste contemplant les vitraux de Notre-Dame, épouse de dompteur côtoyant les fauves, amie de Genet dialoguant avec un génie tourmenté, compagne de Bobin partageant une même conception de la littérature comme ascèse spirituelle : chaque étape de sa vie alimente une poésie qui refuse les chemins convenus. Sa voix singulière, entre mysticisme sensuel et lucidité acérée, fait d’elle une héritière des grandes contemplatives comme Thérèse d’Avila, Hildegarde de Bingen, autant qu’une sœur des poétesses du XXe siècle qui ont osé dire leur vision du monde tels Anna Akhmatova, Marina Tsvetaïeva, Catherine Pozzi ou encore la grande Emily Dickinson.
Une obsession de la beauté comme chemin spirituel
Le Livre des anges déroule une suite de poèmes versifiés d’une densité exceptionnelle. Dès l’ouverture, le lecteur est saisi par une langue qui semble venir d’ailleurs. Lydie Dattas construit son univers poétique autour d’un lexique restreint mais répété avec une obsession presque liturgique, les anges, les roses rouges, le lys blanc, l’aurore, l’azur, la mort, la beauté, le cœur, l’amour. Cette répétition n’est pas monotonie mais plutôt une sorte d’incantation. Comme dans la musique baroque où un thème se varie à l’infini, chaque poème reprend les mêmes motifs pour en explorer une nouvelle facette.
La jeune poétesse écrit depuis l’intérieur d’une expérience qui la dépasse. Elle ne décrit pas la beauté, elle en témoigne comme d’une révélation qui l’a brûlée. « La beauté m’a forcée à lui appartenir », écrit-elle. Cette contrainte exercée par la beauté structure toute l’œuvre. Il ne s’agit pas d’une contemplation esthétique passive mais plutôt d’une lutte, d’un corps à corps spirituel où l’âme se débat et finit par consentir. Les poèmes racontent cette reddition progressive, cette défaite victorieuse où la jeune fille accepte d’être transformée par ce qu’elle voit et ressent.
L’architecture des poèmes frappe par sa rigueur formelle. Lydie Dattas ne se contente pas d’écrire en vers, elle compose des structures métriques complexes où chaque syllabe compte. Cette obsession prosodique, cette maîtrise grammaticale confèrent aux textes une densité musicale qui les apparente aux psaumes ou aux litanies. Le rythme régulier, les anaphores, les parallélismes syntaxiques créent un effet d’hypnose. On lit et on relit les mêmes vers sans épuiser leur mystère.
Prenons ce poème intitulé « Jour et nuit », qui résume l’art de Lydie Dattas « Ma jeunesse a été si absolument pure : / j’ai traversé la nuit sans craindre de mourir, / j’ai marché dans la nuit sans douter de l’aurore / lorsque la nuit doutait de ses propres étoiles. » L’affirmation de la pureté n’est pas narcissisme mais nécessité spirituelle. La jeune fille proclame son innocence comme on proclame une vérité révélée. Cette pureté lui permet de traverser la nuit, métaphore de l’épreuve, du doute, de la souffrance, sans être anéantie. Plus encore, elle marche dans l’obscurité « comme au milieu du jour ». Le paradoxe devient vision mystique.
Les anges, figures centrales du recueil, ne sont pas des créatures mièvres de l’imagerie pieuse. Ils incarnent une puissance intermédiaire entre l’humain et le divin, des messagers qui rendent possible le dialogue avec l’absolu. « Les anges ont préparé mon âme à la beauté », écrit Lydie Dattas. Cette préparation angélique suggère une initiation, un travail invisible accompli dans l’intériorité. Les anges sont aussi ceux qui accompagnent la souffrance, qui empêchent le désespoir de tout emporter « Les anges ont empêché mon amour de faiblir. »
La rose rouge et le lys blanc constituent les deux pôles symboliques de cette poésie. La rose, incarnat de la passion charnelle et du sacrifice (« ces roses qui mouraient à force de beauté »), représente la part de désir et de sensualité. Le lys, blanc immaculé, évoque la pureté virginale et l’aspiration contemplative. Entre ces deux fleurs, la jeune poétesse oscille sans cesse. Elle ne choisit pas mais elle assume plutôt la tension. « J’ai été le portrait craché des roses rouges », affirme-t-elle, revendiquant ainsi sa part de chair et de sang. Mais elle écrit aussi « Le lys blanc a ouvert mon cœur à la beauté », reconnaissant la nécessité de l’ascèse et de l’élévation.
L’aurore et l’azur sont les deux dimensions du ciel qui habitent ces poèmes. L’aurore, moment fragile entre nuit et jour, symbolise le passage, la transformation, l’instant où tout peut basculer. « J’aime d’un amour qui n’aime que l’aurore : la beauté de l’aurore a fait pâlir l’amour. » L’azur, bleu absolu du ciel en plein jour, représente la perfection, l’éternité, le divin lui-même. « Mon âme inaugurée par le bleu de l’azur » la conscience s’ouvre et se constitue au contact de cette transcendance visible.
Le malheur, loin d’être subi passivement, devient ici maître de sagesse. « Le malheur m’a aidée à comprendre l’azur, le malheur a rendu mon cœur intelligent. » Cette assertion, qui pourrait sembler naïve, révèle une profondeur spirituelle rare chez une si jeune autrice. Elle comprend déjà ce que les mystiques de tous les siècles ont enseigné, la souffrance, quand elle est acceptée et traversée, devient voie de connaissance. Le malheur creuse en elle un espace où peut entrer la lumière divine. « Mon âme enfin a vu venir le jour » après avoir enduré la nuit la plus obscure.
La mort, omniprésente dans le recueil, n’effraie pas cette jeune voix. « Je voulais mourir pour la beauté des roses », écrit-elle sans emphase. Ce désir de mort n’est pas nihiliste : il exprime une volonté de fusion avec l’absolu, un désir d’échapper aux limites du monde terrestre. « Mourir pour la beauté » formule étrange qui fait de la beauté une cause digne d’un sacrifice ultime. Cette exaltation, qui pourrait inquiéter, reste équilibrée par une conscience lucide. La jeune poétesse sait qu’elle joue avec le feu, qu’elle s’approche dangereusement du gouffre. Mais elle assume ce risque comme condition même de l’authenticité poétique.
Réponse à Genet et manifeste de la dignité féminine
La Nuit spirituelle, second texte du volume, naît d’une blessure et d’une colère. En 1977, Jean Genet, voisin et ami de Lydie, la bannit de sa vie au motif qu’elle le contredit sans cesse et qu’il déteste les femmes. Cette gifle symbolique pousse la jeune femme de vingt-huit ans à écrire « un poème si beau qu’il l’obligerait à revenir ». Pari tenu, Genet, après avoir lu le manuscrit, lui adresse une lettre d’admiration bouleversée où il compare sa langue à celle de Baudelaire et Nerval.
La Nuit spirituelle pose frontalement la question de la malédiction qui pèse sur la parole féminine. « Que je vienne à les proférer, les mots de soleil et de rose eux-mêmes s’assombriront, et je ne pourrai pas prononcer une parole sans que sur elle se couche l’ombre de la malédiction. » Lydie Dattas met en lumière cette injustice fondamentale, la femme qui parle, qui crée, qui pense, subit une dévalorisation systématique. Ses mots, quand bien même seraient-ils lumineux, seront perçus à travers le filtre du mépris ou du paternalisme.
Mais loin de se lamenter, Lydie transforme cette nuit en source de puissance. « Si je chante, c’est d’une voix sombrée », affirme-t-elle. La noirceur devient paradoxalement le lieu d’un rayonnement. Les ténèbres, au lieu d’éteindre la parole, lui confèrent une intensité nouvelle. Ce texte accomplit ainsi une coïncidence des opposé, la tristesse engendre un rayonnement, la nuit brille, le malheur devient radieux. Pierre Assouline parlera du « malheur radieux » de Lydie Dattas, formule qui saisit parfaitement cette alchimie spirituelle.
La Nuit spirituelle n’est pas un manifeste féministe au sens idéologique du terme. Lydie Dattas ne revendique pas l’égalité par assimilation au modèle masculin. Au contraire, elle affirme la spécificité de la voix féminine, sa nécessité propre, son génie irréductible. Elle écrit : « La danse des sept voiles vaut les pensées de Spinoza ! Maintenir un cœur en fleur sous la cataracte des deuils, réparer d’un sourire une âme meurtrie par la vie, accompagner le mourant jusqu’au soleil, seule une femme en est capable. » Cette affirmation audacieuse renverse la hiérarchie traditionnelle entre le corps et l’esprit, entre la sensibilité et la raison. La danse, art incarné du féminin, vaut la philosophie spéculative. Plus encore, le travail invisible du soin, de la consolation, de l’accompagnement devient ici acte suprême de sagesse.
Ce texte se veut aussi une réponse à Rimbaud, qui appelait de ses vœux une poésie féminine authentique tout en prescrivant aux femmes de se libérer de « l’infini servage » pour devenir poètes. Lydie refuse cette injonction contradictoire. Elle n’écrira pas pour imiter les hommes ni pour correspondre à l’idée qu’ils se font de la poésie féminine. Elle écrira depuis sa propre nuit, depuis sa propre blessure, depuis son propre regard sur le monde. « J’étais cette rose noire qui sautait du bouquet », formule splendide qui résume son refus de toute normalisation.
La provocation comme chemin de vérité
Carnet d’une allumeuse, troisième et dernier texte du volume, écrit en 2017 alors que Lydie Dattas a soixante-neuf ans, constitue une pièce radicalement différente. Le titre lui-même provoque. Une « allumeuse » désigne dans le langage commun une femme qui séduit sans intention de donner suite, qui joue avec le désir masculin. Lydie Dattas retourne le stigmate en étendard. Elle assume sa beauté passée, son pouvoir de séduction, sa capacité à fasciner « Hier, ma beauté était un lilas aux yeux perçants, à quoi aucun garçon ne résistait, que toutes les filles jalousaient. »
Ce texte possède une dimension autobiographique plus marquée que les précédents. On y sent la liberté d’une femme mûre qui regarde son existence avec lucidité et sans concession. L’écriture se fait plus scandée, plus âpre, presque pamphlétaire. Le « Carnet » fonctionne comme une réponse à Une saison en enfer de Rimbaud. Lydie cherche à se délivrer de l’autorité rimbaldienne tout en honorant son génie. Elle refuse le féminisme décadent qu’elle perçoit dans certains discours contemporains, cette nouvelle forme de soumission au modèle masculin qui consiste à renier sa féminité pour être reconnue.
Le vocabulaire change. Aux roses et aux lys du Livre des anges succèdent des images plus charnelles, plus violentes, plus crues. « Ma bouche était un corail d’absolu », « J’étais cette rose noire qui sautait du bouquet », « Aucun homme ne songe à la pourpre qui pleut sous la robe des reines ». Le corps féminin devient territoire politique, lieu d’une guerre silencieuse où se joue la question de la liberté. La beauté n’est plus seulement promesse spirituelle : elle est aussi piège, fardeau, malédiction sociale.
Ce texte porte également le suicide, l’horreur, une forme d’anti-religiosité. La tonalité se fait plus sombre, plus désenchantée. Pourtant, même dans cette noirceur, Lydie maintient son exigence de vérité. Elle refuse les mensonges consolateurs, les compromis intellectuels, les faux-semblants. « Puisque la vérité est la volupté pure » cette phrase, située en épigraphe du recueil, résume son éthique. La vérité, fût-elle douloureuse, procure une jouissance supérieure à tous les arrangements avec la réalité.
Chaque chapitre se ponctue de phrases en italique, probablement issues de correspondances amoureuses ou filiales. Ces fragments ajoutent un caractère trouble, énigmatique. Impossible de savoir s’il s’agit de lettres reçues ou imaginées, d’amours réelles ou fantasmées. Cette ambiguïté nourrit la dimension mythopoétique du texte. Lydie Dattas ne se contente pas de raconter sa vie, elle la transforme en légende, en matériau mythologique.
De la féminité comme voie spirituelle spécifique
L’œuvre de Lydie Dattas pose une question philosophique fondamentale : existe-t-il une spiritualité spécifiquement féminine ? Une voie d’éveil qui passerait par l’expérience sensible, par la beauté des formes, par la relation au corps et aux éléments naturels plutôt que par l’ascèse mortifiante ou la spéculation abstraite ?
La tradition mystique occidentale a longtemps minoré, voire condamné, cette dimension incarnée de la quête spirituelle. Lydie Dattas, sans le formuler en termes conceptuels, propose une autre voie. Chez elle, la contemplation des roses et l’adoration de l’azur constituent des exercices spirituels aussi légitimes que la méditation silencieuse ou l’étude des textes sacrés. L’émerveillement devant la beauté naturelle ouvre l’âme à la transcendance. « J’ai appris à penser en regardant l’aurore, j’ai appris à aimer en admirant les roses » ces vers énoncent une véritable philosophie de la connaissance sensible.
Cette approche rappelle certaines intuitions de la pensée présocratique, notamment chez Héraclite, pour qui le monde visible est langage divin, logos incarné qu’il faut apprendre à déchiffrer. Elle évoque aussi la mystique rhénane, celle de Maître Eckhart ou d’Hildegarde de Bingen, qui célèbrent la « verdeur » (viriditas) du monde comme manifestation de l’énergie divine. Mais Lydie Dattas ne philosophe pas : elle chante. Sa pensée s’exprime en images, en rythmes, en couleurs. Elle pense poétiquement.
La question du malheur occupe une place centrale dans sa philosophie implicite. Comment transformer la souffrance en sagesse ? Comment faire de la nuit un lieu de vision ? Les mystiques de toutes traditions ont exploré cette alchimie spirituelle. Saint Jean de la Croix parle de la « nuit obscure de l’âme », ce passage obligé où Dieu se retire pour permettre à l’âme de grandir dans la foi pure. Lydie Dattas connaît cette nuit, mais elle la vit depuis son corps de femme, depuis son expérience de jeune fille confrontée à la beauté et à la mort, au désir et au renoncement.
« Le malheur a rendu mon cœur intelligent » cette affirmation renverse la valorisation habituelle de l’intelligence rationnelle. Il ne s’agit pas d’une intelligence qui calcule ou qui dissèque, mais d’une intelligence du cœur, d’une capacité à comprendre depuis l’émotion, depuis la blessure, depuis l’amour. Cette intelligence cordiale, à laquelle Pascal faisait déjà allusion (« Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point »), devient ici principe de connaissance supérieure.
La figure de l’ange, si présente dans l’œuvre, mérite également une réflexion philosophique. Dans la tradition théologique, les anges sont des intelligences pures, des êtres de contemplation qui voient Dieu face à face. Lydie Dattas leur attribue une autre fonction : ils préparent l’âme à recevoir la beauté, ils accompagnent la souffrance, ils empêchent le désespoir de tout anéantir. Autrement dit, ils jouent un rôle de médiation entre le divin inaccessible et l’humain limité. Ils rendent possible la relation mystique. Cette conception rappelle celle de Denys l’Aréopagite, pour qui les anges forment une hiérarchie permettant à la lumière divine de descendre jusqu’à nous sans nous consumer.
La relation entre féminité et spiritualité se pose aussi en termes de transgression. La jeune fille qui dialogue avec les anges, qui prétend « vaquer aux travaux des anges » alors que « tout le féminin troupeau se rendait au point d’eau d’un miroir », revendique une forme d’élection. Elle refuse la place assignée à son sexe, celle du miroir, de la séduction superficielle, de la soumission au regard masculi, pour accéder à une dimension supérieure. Cette transgression fonde la légitimité de sa parole poétique.
Enfin, l’œuvre interroge le rapport entre beauté et vérité. « Puisque la vérité est la volupté pure » : cette équation audacieuse identifie trois termes habituellement dissociés. La vérité n’est pas froide abstraction mais jouissance sensible. La beauté n’est pas ornement superficiel mais révélation de l’être. La volupté n’est pas plaisir coupable mais expérience métaphysique. Dans cette fusion, Lydie Dattas rejoint les intuitions de Platon dans le Banquet, où Diotime enseigne que l’amour de la beauté sensible peut devenir échelle vers la contemplation du Beau absolu.
Une œuvre qui traverse les époques en restant jeune
Plus de cinquante ans séparent l’écriture du Livre des anges de la publication de ce volume Gallimard en 2020. Pourtant, ces poèmes n’ont pas vieilli. Ils conservent leur étrangeté radicale, leur pouvoir de fascination. Comment expliquer cette pérennité ?
D’abord, la langue de Lydie Dattas ne suit aucune mode. Elle n’appartient ni au surréalisme ni à la poésie contemporaine fragmentée. Elle invente sa propre tradition, puisant aux sources du lyrisme éternel, celui des Psaumes, de Sappho, de Pétrarque, pour forger une parole immédiatement reconnaissable. Cette voix singulière échappe à tout classement chronologique. On pourrait la situer au XIXe siècle finissant aussi bien qu’au XXIe siècle commençant.
Ensuite, les thématiques abordées, la beauté, la souffrance, le désir d’absolu, la condition féminine, le rapport au divin, restent brûlantes d’actualité. Chaque génération doit réinventer sa relation à ces questions fondamentales. Le témoignage de Lydie Dattas offre une voie possible, un exemple de radicalité assumée. Dans un monde où tout se nivelle, où les discours se standardisent, cette voix insoumise rappelle qu’il est possible de parler depuis sa propre vérité, sans concession.
La force particulière du Livre des anges tient à sa pureté. Ces poèmes, écrits par une adolescente, n’ont subi aucune contamination cynique. Ils procèdent d’une intégrité que les épreuves de la vie n’ont pas entamée. Christian Bobin, dans sa préface magnifique, situe Lydie Dattas aux côtés d’Emily Dickinson, Simone Weil, Catherine Pozzi, Thérèse d’Avila, toutes ces « compagnes d’ascension vers le Soleil du Verbe ». Cette filiation prestigieuse ne l’écrase pas, elle la légitime.
La Nuit spirituelle et Carnet d’une allumeuse, écrits à des âges plus mûrs, complexifient le portrait. La poétesse foudroyée de Le Livre des anges devient la femme lucide qui regarde sa vie en face, qui refuse les mensonges, qui accepte les contradictions. Cette évolution enrichit le volume sans trahir la promesse initiale. Au contraire, elle prouve que la jeune fille qui parlait aux anges n’était pas une mystique naïve mais une conscience en chemin, une voyageuse spirituelle qui n’a cessé d’approfondir sa quête.
Pour le public de Voie Poétique, cette œuvre résonne particulièrement. Elle incarne exactement ce que nous cherchons : une poésie exigeante qui refuse la facilité, une parole qui ose affronter les questions métaphysiques, une écriture qui fait de la beauté une religion. Lydie Dattas appartient à cette lignée de poètes visionnaires qui transforment l’existence en matière spirituelle. Elle nous rappelle que la poésie n’est pas divertissement culturel mais nécessité vitale, chemin vers l’éveil, dialogue avec l’invisible.
Le lecteur contemporain, souvent perdu dans la cacophonie médiatique et l’horizontalité du discours ambiant, trouvera ici une verticalité salvatrice. Ces poèmes invitent à la lenteur, à la relecture, à la méditation. Ils résistent à la consommation rapide. Chaque vers demande à être pesé, savouré, intériorisé. Cette résistance même constitue leur plus grande vertu, ils nous obligent à ralentir, à creuser, à chercher sous la surface des mots cette vérité que Lydie nomme « volupté pure ».
- Titre complet : Le Livre des anges suivi de La Nuit spirituelle et de Carnet d’une allumeuse
- Auteur : Lydie Dattas
- Éditeur : Gallimard, collection Poésie/Gallimard – Site de Gallimard
- Année de publication : 4 juin 2020
- Nombre de pages : 274 pages
- ISBN : 978-2-07-289148-9
Préface : Christian Bobin (pour Le Livre des anges) et Jean Grosjean (préface historique)
Pour commander cet ouvrage : La Librairie