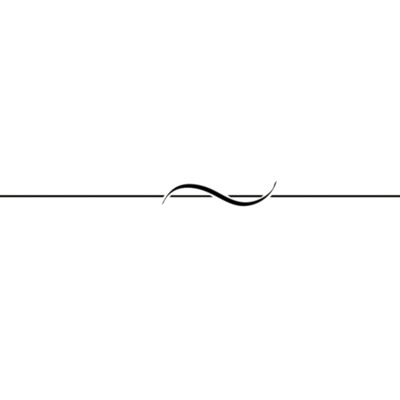Audio transcription :
La marche est un art, une méditation en mouvement, une façon d’habiter le monde avec plus de lenteur et d’attention. De nombreux auteurs ont célébré les vertus de la promenade : Rousseau, Thoreau, Nietzsche, Walter Benjamin, chacun à sa manière, a vu dans la marche une activité essentielle, presque philosophique. C’est dans cette lignée que s’inscrit Karl Gottlob Schelle, auteur du XIXe siècle, qui livre dans L’art de se promener une réflexion sur la marche et ses bienfaits.
À première vue, le sujet a tout pour me plaire : une ode à la lenteur, une célébration du vagabondage intérieur et extérieur, un éloge du corps en mouvement dans l’espace. Et pourtant, à la lecture de cet ouvrage, je suis resté mitigé. Il y a du bon dans ce texte, des passages intéressants, mais aussi des lourdeurs, des répétitions, et une approche qui manque parfois de souffle et de profondeur.
Un texte ancien, une pensée parfois datée
Il faut rappeler que Karl Gottlob Schelle écrit en 1802. Son texte appartient à une époque où la marche commence à être réévaluée comme une pratique noble, non plus seulement un moyen de déplacement, mais un acte de réflexion, une expérience spirituelle. Il précède ainsi les Romantiques et les philosophes piétons du XIXe siècle, et l’on peut saluer son intuition visionnaire.
Là où le livre perd un peu en intérêt, c’est dans son ton trop descriptif et parfois moralisateur. Schelle ne cherche pas tant à nous faire ressentir la promenade qu’à nous dire comment elle devrait être pratiquée, pourquoi elle est bénéfique, et en quoi elle nous grandit.
Or, la marche est avant tout une expérience sensorielle et intime. La réflexion de Schelle reste trop rationnelle, comme s’il s’agissait de convaincre un tribunal de la valeur de la promenade. On aurait aimé plus d’évasion, plus de poésie, plus de ressenti personnel.
Les points forts du livre
Malgré mes réserves, L’art de se promener a de réelles qualités.
-
Un témoignage historique intéressant
Schelle écrit à une époque où la marche est encore perçue comme une activité triviale. En cela, il s’inscrit dans un mouvement de réhabilitation, où la promenade devient un acte philosophique, esthétique et moral. Il est un précurseur de ce qui deviendra, plus tard, une tradition intellectuelle forte. -
Des réflexions pertinentes sur les bienfaits de la marche
Schelle évoque les bienfaits physiques et mentaux de la promenade, et certains passages résonnent encore aujourd’hui. Il parle de la marche comme d’un équilibre entre le corps et l’esprit, comme un moyen de se recentrer et d’échapper aux troubles de l’âme. -
Un livre accessible
Contrairement à certains traités philosophiques complexes, ce livre reste facile à lire. Il peut être une introduction intéressante à la réflexion sur la marche, même si d’autres auteurs ont, depuis, approfondi ce sujet avec plus de finesse.
Les limites du livre
-
Un ton professoral et un manque de lyrisme
L’un des grands défauts du texte est son ton trop académique. On ne ressent pas chez Schelle la joie pure de la promenade, cette sensation de liberté, d’évasion, de dilatation de l’être que l’on retrouve chez un Rousseau ou un Thoreau. -
Un manque d’ancrage dans le sensible
Schelle parle beaucoup de la promenade de manière théorique, mais il nous manque le vent dans les arbres, la sensation des pierres sous le pied, l’odeur de la terre après la pluie. Son texte aurait gagné à être plus incarné, plus sensoriel, plus vivant. -
Une approche parfois trop normative
L’auteur ne se contente pas de vanter la marche, il semble vouloir dicter comment il faut se promener. Or, la beauté de la marche réside justement dans sa liberté absolue, dans le fait qu’elle ne répond à aucun dogme, aucun mode d’emploi.
Un livre pour qui ?
Si vous êtes passionné par l’histoire des idées, ce livre peut être intéressant, ne serait-ce que pour comprendre comment la marche est devenue un sujet philosophique. Mais si vous recherchez un texte vibrant, poétique, capable de vous donner envie de partir marcher dès la première page, mieux vaut vous tourner vers Henry David Thoreau (De la marche), Frédéric Gros (Marcher, une philosophie) ou encore Sylvain Tesson.
Conclusion : Une lecture en demi-teinte
L’art de se promener est un livre intéressant, mais pas captivant. Il propose une réflexion historique et philosophique sur la marche, mais manque d’émotion et de chair. Il reste une curiosité, un texte à lire pour comprendre une époque, mais pas une œuvre qui marque profondément l’âme du lecteur.
En refermant ce livre, je n’ai pas eu cette irrésistible envie de chausser mes bottes et d’aller marcher. Or, pour un ouvrage qui prétend célébrer la promenade, c’est peut-être là son plus grand échec.
David – Poète & Philosophe