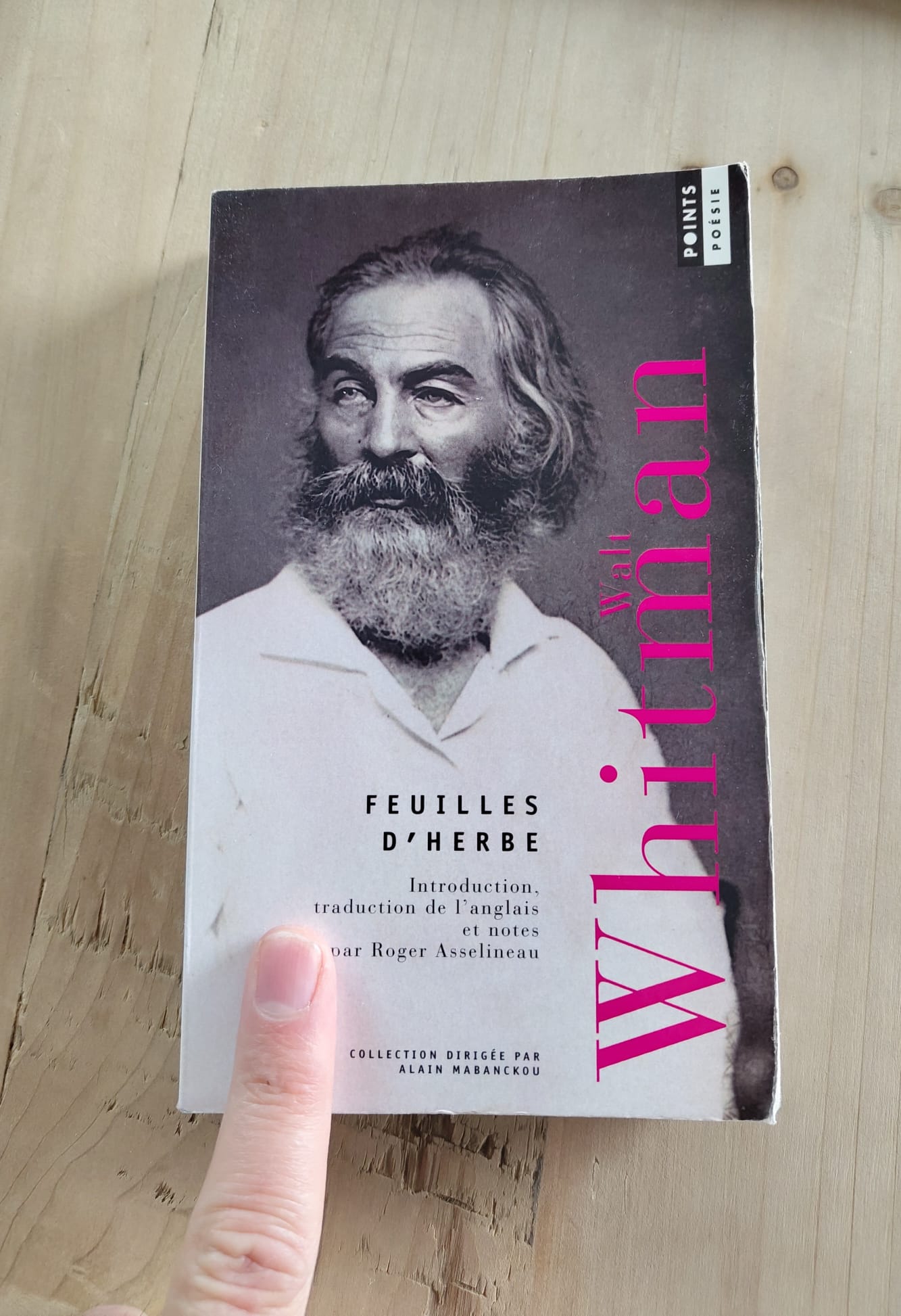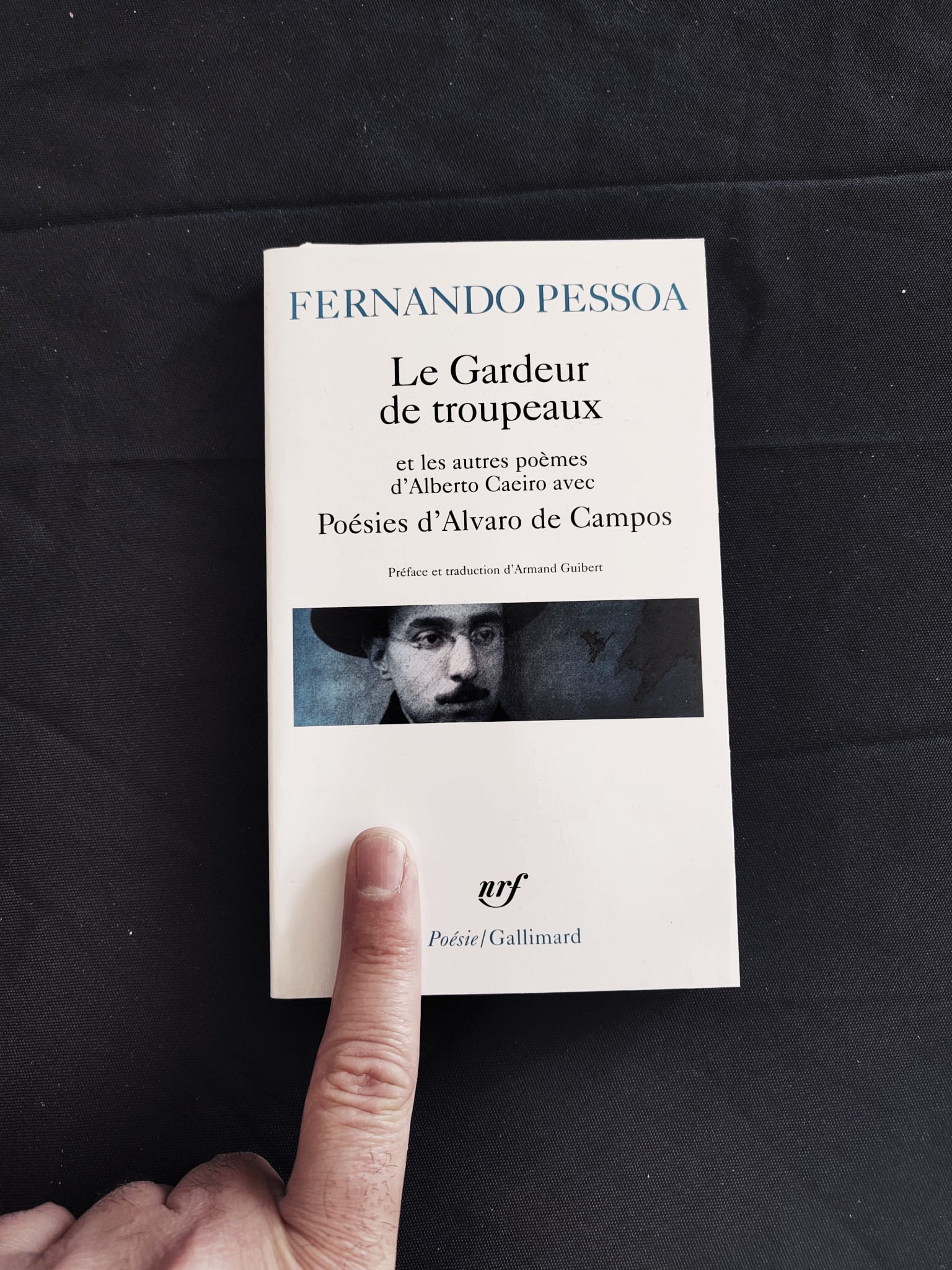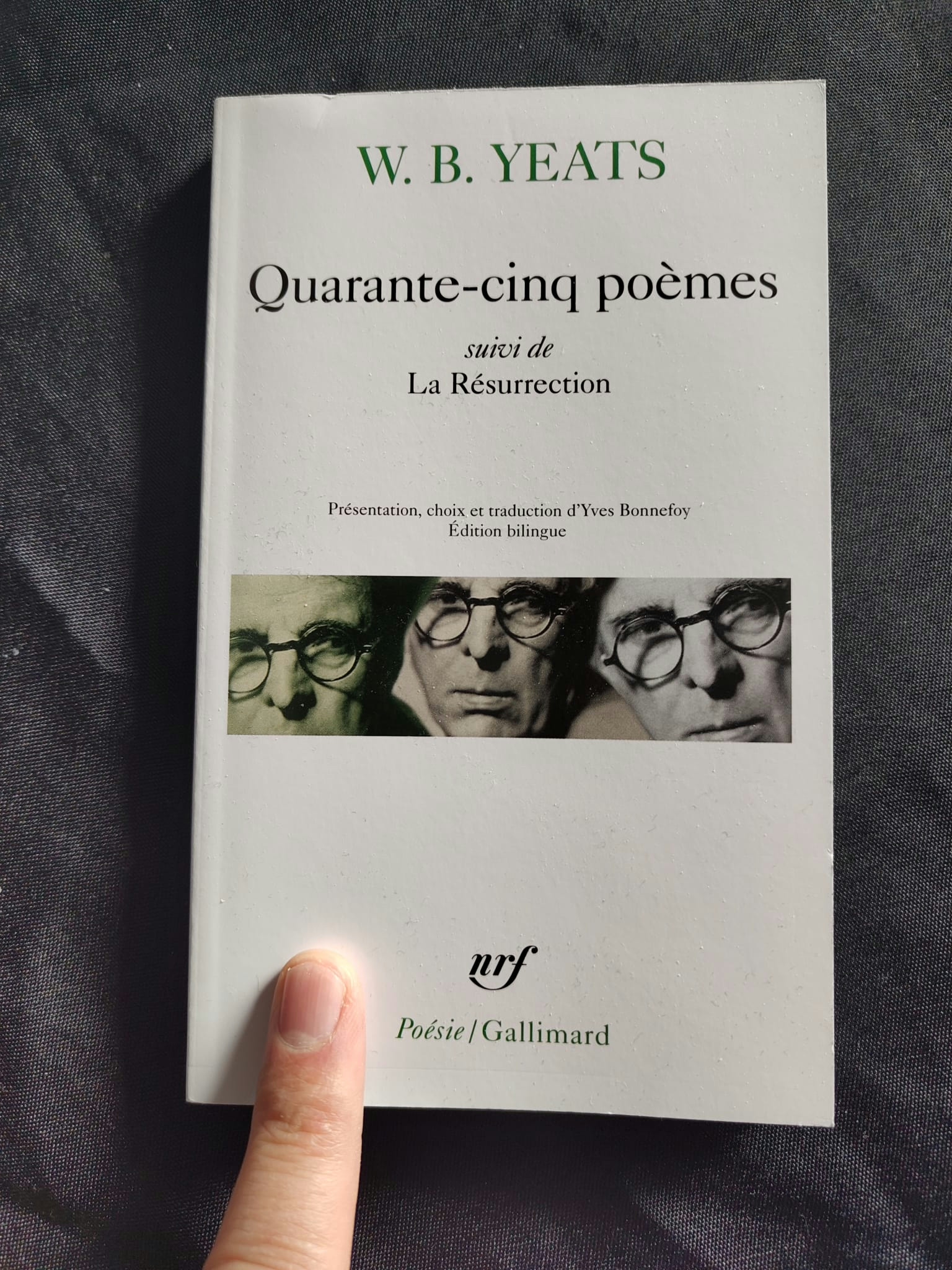Les éditions Les Bonnes Feuilles m’ont fait parvenir gracieusement cet ouvrage pour en rédiger la présente recension. Je les remercie infiniment pour cette contribution à mes recensions poétiques.
Le livre de Léo Poirier est de ceux qui nous ramènent à l’instant d’avant la parole, au moment précis où le regard rencontre la matière et où quelque chose commence à trembler dans la conscience. Primaires appartient à cette famille d’œuvres qui interrogent non pas ce que nous voyons, mais comment nous voyons, non pas le paysage mais l’acte même de percevoir. Dès l’ouverture de l’enveloppe contenant l’ouvrage, c’est la couverture qui a commencé à m’interpeller, voir me parler : une surface de pierre craquelée, fendue, traversée de fissures qui dessinent un réseau organique. Cette texture pourrait être celle d’une terre assoiffée, d’un mur ancien, d’une peau marquée par le temps. L’indétermination est volontaire. Car ce que Poirier explore, ce n’est pas l’objet mais le moment fragile où l’objet advient à la conscience.
Publié par Les Bonnes Feuilles qui est une jeune maison parisienne qui continue l’aventure des éditions Poésie.io, ce recueil porte en lui une radicalité discrète, celle de la poésie comme archéologie du sensible, comme tentative de remonter aux sources premières, primaires, de l’expérience.
Une éloge de la matière blessée…
La photographie de couverture, vous disais-je, ne ment pas sur le projet du livre. Elle montre une surface minérale photographiée de près, suffisamment près pour qu’on ne sache plus exactement ce que l’on regarde. Les craquelures y dessinent un labyrinthe de lignes sombres sur fond gris et ocre. Ces failles ne sont pas des défauts, elles sont la preuve que la matière a vécu, qu’elle a été travaillée par le temps, l’érosion, peut-être la sécheresse… Les teintes sont celles de la pierre et de la terre, bruns profonds, gris de cendre, ocres chaleureux, blancs calcaires. Aucune couleur vive ne vient perturber cette gamme austère. C’est une palette primaire dans un sens inattendu et non pas les trois couleurs fondamentales du spectre, mais les couleurs premières de la Terre, celles qui existaient avant l’homme, avant la culture, avant le langage.
Cette image n’est à mon sens pas simplement décorative. Elle constitue un seuil, une initiation visuelle à ce qui va suivre. La fissure y apparaît comme figure philosophique centrale. Héraclite disait que la nature aime à se cacher. Ici, c’est par la faille que la structure profonde se révèle. Ce n’est que lorsque la surface se rompt que nous pouvons voir comment elle est faite. La photographie célèbre donc une beauté de la vulnérabilité en nous suggérant que les choses belles ne sont pas les choses intactes, mais celles qui portent les traces de leur propre histoire, les stigmates de leur rencontre avec le monde.
Le choix d’une image abstraite, ne représentant rien d’identifiable, ni personnage ni paysage reconnaissable, confère à la couverture une dimension universelle. Chaque lecteur peut y projeter ses propres associations… sol d’un désert, mur d’une ville en ruine, écorce d’un arbre millénaire, peau marquée par les années. Cette indétermination est une véritable richesse. Elle ouvre l’imaginaire au lieu de le contraindre. Et elle annonce le geste poétique de Poirier, celui de ne pas nommer directement, mais créer les conditions d’une vision.
Le titre, Primaires, s’inscrit sobrement sous le nom de l’auteur. Ce mot polysémique résonne immédiatement. Il évoque d’abord les couleurs primaires rouge, bleu, jaune à partir desquelles toutes les autres se composent. Il suggère aussi le primitif, l’originel, ce qui vient en premier dans l’ordre temporel ou logique. En géologie, les roches primaires sont les plus anciennes, formées aux premières ères de la planète. En chimie, les structures primaires sont les plus élémentaires. Mais surtout, en lisant le recueil, j’ai compris que « primaire » désigne ici le moment premier de la perception, cet instant infinitésimal où le réel touche la conscience, avant toute conceptualisation, avant que le langage ne vienne découper l’expérience en catégories.
Une voix qui cherche à remonter aux sources
Les informations biographiques sur Léo Poirier demeurent discrètes, j’ai longtemps cherché de l’info sur le web sans rien trouver, mais cette discrétion s’accorde avec la démarche de l’œuvre au fond. Alors, il existe un Léon Poirier, avec un « n », poète également, dramaturge et libraire chez Tschann à Paris, président fondateur de la revue Congre, actif dans le paysage poétique contemporain. Mais notre Léo, ayant perdu son « n » semble cultiver un effacement volontaire. Aucune biographie flamboyante, aucun palmarès médiatique, aucun récit romanesque. Juste une œuvre, sobre et exigeante, qui doit parler pour elle-même.
Ce choix de discrétion est cohérent avec l’esthétique du recueil. Poirier ne se met pas en scène. Il n’y a presque aucun « je » lyrique dans Primaires. Le poète s’efface derrière ce qu’il perçoit. Comme il l’écrit lui-même dans sa postface « Dans ce recueil il y a beaucoup de paysages, et tout compte fait presque aucune présence humaine. J’ai souvent pensé que ce que j’écrivais, décrivais, n’était pas habité. » Pourtant, ajoute-t-il, cette absence apparente cache une présence essentielle, celle du regard qui fait advenir le paysage. « Sans le contemplateur, le paysage n’existe pas vraiment, il ne fait que se tenir là. »
Cette réflexion place immédiatement Poirier dans la lignée de la phénoménologie française, et particulièrement de Maurice Merleau-Ponty dont une citation ouvre le recueil. Le philosophe écrivait « Il y a donc dans la perception un paradoxe de l’immanence et de la transcendance. Immanence, puisque le perçu ne saurait être étranger à celui qui perçoit et transcendance, puisqu’il comporte toujours un au-delà de ce qui est actuellement donné. » C’est exactement ce paradoxe que Poirier explore poétiquement, comment le monde est-il à la fois en nous (car nous le percevons) et hors de nous (car il nous dépasse) ?
Publier chez Les Bonnes Feuilles n’est pas anodin, je pense. Cette jeune maison d’édition parisienne, lancée en 2025 dans la continuité de Poésie.io, s’est donnée pour mission de « réinventer l’édition pour faire émerger de nouveaux auteurs ». Leur ligne éditoriale, qu’ils qualifient de « sensible, moderne, puissante », privilégie les voix singulières qui refusent les facilités commerciales et les effets de mode. Avec près de 30 000 abonnés sur Instagram et un Prix des lecteurs mensuel, Les Bonnes Feuilles incarnent un nouvel âge de l’édition indépendante, numérique dans ses outils, mais fidèle à l’exigence littéraire dans ses choix. Que Léo Poirier ait trouvé refuge dans ce catalogue témoigne d’une cohérence, son œuvre a besoin d’un écrin qui respecte sa radicalité discrète.
Une géologie de l’instant
Le sommaire de Primaires révèle immédiatement le principe organisateur du recueil. Chaque poème porte le nom d’un minéral, d’une pierre précieuse ou d’un élément chimique : Topaze, Sélénium, Tourmaline, Galène, Grenat, Phlogopite, Cornaline, Feldspath, Citrine, Ambre, Quartz, Ocre, Granite, Olivine, Corall, Lapis-lazuli, Cobalt, Aigue-marine… Cette nomenclature minéralogique n’est pas gratuite. Elle indique d’emblée que nous sommes dans une poésie de la matière, une poésie qui cherche à cristalliser des instants de perception pure.
Pourquoi des minéraux ? Parce qu’ils incarnent le primaire au sens géologique, ce qui est là depuis les origines, ce qui précède la vie organique, ce qui constitue le substrat inerte sur lequel tout le reste s’est construit. Mais aussi parce que chaque minéral possède une structure cristalline unique, une géométrie interne qui détermine ses propriétés. De même, chaque poème de Poirier cristallise un instant perceptif singulier, avec sa géométrie propre, sa densité, sa couleur.
Prenons « Topaze », poème inaugural qui donne le ton :
« Tremblement sur les feuilles, / Alors qu’est déclamée / Silencieusement / L’incantation du soleil. / Les pierres des ponts, / Les rides de la Seine / Ainsi que quelques toits / Se souviennent encore / De l’éclat du jour / Qui s’ombre, à l’abri / Du regard, du feu. »
Dès ces premiers vers, la méthode Poirier se déploie. Il ne décrit pas un paysage de manière continue et narrative. Il procède par touches, par fragments, par notations brèves. « Tremblement sur les feuilles » un mouvement infinitésimal, à peine perceptible. « L’incantation du soleil » le soleil devient acteur, presque personnage, mais dans le silence. Les pierres, les rides de la Seine, les toits voici autant d’éléments qui « se souviennent » de la lumière. Poirier anthropomorphise discrètement la matière inanimée. Les pierres ont une mémoire lumineuse. Ce n’est pas une métaphore facile, c’est l’expression d’une intuition profonde. La pierre garde en elle la trace de tous les soleils qui l’ont éclairée. Elle est imprégnée de lumière.
La langue de Poirier est d’une grande économie. Pas de bavardage lyrique, pas d’effusions sentimentales. Chaque mot pèse, chaque vers creuse. Les phrases sont souvent nominales ou elliptiques. Les tirets abondent, créant des pauses, des suspensions, des blancs dans lesquels le sens vibre. Cette poésie mime la perception elle-même à la fois fragmentaire, discontinue, faite de saillances et de retraits.
Passons à « Sélénium », dont le titre évoque à la fois l’élément chimique et la lune (Séléné, déesse grecque de la lune) :
« Le soleil s’élève / Dans le creux du viaduc / Et à travers les persiennes / Mi-closes – sur le bois / Des flambeaux et de la roue. // Le verre s’éveille / Pour le recueillir – pour voir – / Dans la diffraction / Le dévoilement d’un ciel. / Au plus profond, les yeux – / Les élèves aux hauts blancs. »
Ici, Poirier explore la médiation de la lumière. Le soleil ne se donne pas directement. Il passe par le creux du viaduc, à travers des persiennes mi-closes. La lumière est toujours filtrée, diffractée. Et le verre, une vitre, sans doute, « s’éveille » la matière devient sensible, presque consciente. Elle « recueille » la lumière « pour voir ». Magnifique renversement. Ce n’est pas nous qui voyons à travers le verre, c’est le verre qui voit à travers nous. Ou plutôt, la vision est un processus où sujet et objet s’interpénètrent.
La fin du poème est étonnante « Au plus profond, les yeux – / Les élèves aux hauts blancs. » « Élèves » au double sens, les élèves de l’école (les enfants) et la pupille de l’œil (qui se dit « élève » en ancien français médical). Cette homophonie ouvre un espace ambigu. Les yeux des élèves, levés vers le blanc du ciel ? Ou les pupilles elles-mêmes, ces trous noirs au centre de l’œil où entre la lumière ? La langue vacille, hésite. Et c’est précisément dans cette hésitation que le poème trouve sa vérité.
Au final, la structure des poèmes est remarquablement cohérente à travers le recueil. Poirier travaille avec des vers courts, souvent de 2 à 6 syllabes, rarement plus longs. Cette brièveté crée un rythme saccadé, hésitant, qui mime l’attention fragmentaire. Les strophes sont courtes (1 à 4 vers), séparées par des blancs importants. Ces blancs ne sont pas du vide : ils sont de l’espace où le sens peut résonner. La ponctuation est rare, peu de points, beaucoup de virgules et de tirets. Les tirets en particulier fonctionnent comme des suspensions, des hésitations, des interruptions dans le flux du langage.
Cette écriture fragmentaire n’est pas gratuite. Elle découle directement du projet phénoménologique de Poirier. Si l’on veut capter la perception dans son surgissement premier, on ne peut pas utiliser les grandes phrases continues de la prose classique. Il faut trouver une syntaxe brisée, trouée, qui laisse passer les blancs, les silences, les hésitations de la conscience percevante.
Habiter le paradoxe de la perception
La postface de Primaires, signée des initiales L.P., constitue une clé de lecture essentielle. Poirier y explicite sa démarche avec une clarté rare chez les poètes. Il écrit « Dans ce recueil il y a beaucoup de paysages, et tout compte fait presque aucune présence humaine. J’ai souvent pensé que ce que j’écrivais, décrivais, n’était pas habité. Puis je me suis rendu compte que la description que je faisais de ces espaces ne pouvait pas être faite sans que quelqu’un l’habite, la perçoive. »
Cette prise de conscience est fondamentale. Elle rejoint directement la phénoménologie de Husserl et de Merleau-Ponty, il n’y a pas de monde sans conscience du monde, mais inversement, il n’y a pas de conscience sans monde perçu. Le sujet et l’objet, le voyant et le visible, le touchant et le touché sont indissociables. Merleau-Ponty parlait de « chiasme » pour désigner cet entrecroisement. Poirier, lui, parle d’habitation. Le paysage n’existe pas vraiment tant qu’il n’est pas habité par un regard. Mais habiter ne signifie pas projeter arbitrairement nos fantasmes sur le réel. Cela signifie au contraire s’ouvrir à ce que le réel donne à voir.
« Sans le contemplateur, le paysage n’existe pas vraiment, il ne fait que se tenir là », écrit Poirier. Le paysage est donc en attente. Il est potentialité pure. C’est seulement « dès lors qu’un observateur passe » que « le paysage se donne à voir, il se projette au delà de lui-même, pour finalement être recomposé dans l’œil du marcheur. » Magnifique formule, le paysage se projette, il est actif, il vient à la rencontre du regard. Et il est « recomposé » – il ne se donne pas tel quel, il doit être réassemblé, reconstruit par la perception. Voir, c’est toujours composer, c’est-à-dire créer.
Poirier poursuit « C’est par nous que l’espace est habité ; non pas que l’on y projetterait vainement un esprit imaginé, mais plutôt qu’il ne prend sens qu’à partir du moment où cette signification peut être accueillie, perçue. » Cette phrase trace une ligne de démarcation importante. Il ne s’agit pas de projeter sur le monde nos désirs ou nos fantasmes (ce serait de l’idéalisme naïf, non?). Il s’agit de reconnaître que le sens émerge de la rencontre entre un monde et une conscience. Le sens n’est ni purement objectif (dans les choses) ni purement subjectif (dans l’esprit). Il est relationnel, il naît de la relation.
Mais Poirier va plus loin encore. Il écrit « Cependant, toute perception n’est jamais uniquement une réception d’informations. À travers le prisme de nos sens, il est toujours, au delà de l’énumération quantitative, un certain effet, une alchimie interne, mélange de protéines et de rêves, de souvenirs et d’influx nerveux. » Cette « alchimie interne » est magnifiquement nommée : mélange de protéines (le corps biologique) et de rêves (l’imaginaire), de souvenirs (la mémoire) et d’influx nerveux (la physiologie). Percevoir, ce n’est jamais recevoir passivement des données. C’est toujours déjà interpréter, métaboliser, transformer.
Et c’est là que réside l’ambition ultime de Primaires « Pour peu que l’on s’y penche, parfois en amont même de l’élaboration d’une scène réaliste, j’ai voulu remonter à la source. » Remonter à la source : voilà le projet. Aller en deçà de la « scène réaliste » constituée, redescendre vers le moment primaire où la perception s’élabore, avant que le langage et les catégories ne viennent découper l’expérience. C’est un projet impossible, bien sûr, car on ne peut pas échapper au langage en utilisant le langage. Mais c’est un impossible nécessaire, une utopie régulatrice qui pousse la poésie vers ses limites.
La citation de Merleau-Ponty qui ouvre le recueil prend alors tout son sens « Il y a donc dans la perception un paradoxe de l’immanence et de la transcendance. » Le monde perçu est à la fois en nous (immanent) et hors de nous (transcendant). Il est à la fois familier et étranger. C’est ce paradoxe que Poirier habite poétiquement. Ses poèmes ne cherchent pas à résoudre le paradoxe, ce serait le tuer. Ils cherchent à le maintenir vivant, à le faire vibrer dans la langue.
Cette démarche rejoint aussi, quoique de manière indirecte, certaines pratiques contemplatives orientales. Le bouddhisme zen, par exemple, insiste sur la « vision nue » (pratyakṣa), cette perception directe qui précède la conceptualisation. Voir une fleur avant de penser « fleur », avant de la classer dans une catégorie. Poirier semble tendre vers quelque chose de similaire : voir la pierre, le ciel, la lumière avant de les nommer, ou du moins essayer de nommer d’une manière qui respecte cette antériorité de la perception sur le concept.
La dimension écologique de l’œuvre, bien que discrète, ne doit pas être négligée. En nous ramenant à la matière minérale, aux pierres, aux éléments, Poirier nous rappelle que nous habitons un monde matériel, que nous sommes entourés de choses qui nous précèdent et nous survivront. À l’heure de la crise environnementale, cette attention à la matière du monde, à sa texture, à sa résistance, prend une résonance particulière. Poirier ne fait pas de militantisme écologique explicite, mais sa poésie enseigne une forme de respect pour la matière, une reconnaissance de son altérité et de sa dignité.
Une œuvre nécessaire à notre époque
Primaires paraît à un moment où la littérature française semble souvent hésiter entre facilité narcissique et virtuosité gratuite. Face à cette double tentation, Poirier propose ici un chemin étroit et exigeant, celui d’une poésie qui cherche à voir vraiment, à percevoir vraiment, en deçà des habitudes et des automatismes. C’est une poésie ascétique dans le meilleur sens du terme, elle pratique un dépouillement, un désencombrement du regard.
À l’heure des écrans omniprésents et des réalités virtuelles, ce recueil rappelle l’importance du contact avec la matière sensible : la pierre, la lumière, l’air, l’eau. À l’heure de l’accélération généralisée, il invite à ralentir, à s’arrêter, à contempler. À l’heure du bavardage médiatique incessant, il pratique l’économie de la parole, le silence habité.
Ce premier recueil s’adresse à plusieurs types de lecteurs. Les amateurs de poésie contemporaine y trouveront une voix qui renoue avec l’exigence d’un mallarmé au vers ciselé, tout en l’ouvrant vers une phénoménologie du quotidien. Les philosophes y reconnaîtront une mise en œuvre poétique des intuitions de Merleau-Ponty sur la perception et le corps. Les contemplatifs y découvriront une pratique de l’attention qui rappelle certaines formes de méditation. Les chercheurs de simplicité y trouveront une poétique du dépouillement, de l’essentiel préservé.
Primaires n’est pas un livre facile. Il ne se donne pas au premier regard. Il faut accepter de ralentir, de s’arrêter sur chaque poème, de les relire plusieurs fois. Ces textes demandent une lecture lente, attentive, presque méditative. Mais cette lenteur est précisément ce que le livre enseigne, prendre le temps de voir, de sentir, de percevoir.
Les photographies en noir et blanc qui ponctuent le recueil prolongent cette esthétique. On y voit des silhouettes en contre-jour, des paysages abstraits, des matières travaillées par la lumière et l’ombre. Ces images ne sont pas illustratives. Elles fonctionnent comme des respirations visuelles, des moments où le langage se tait et laisse place à la pure vision.
Primaires marque l’entrée d’une voix singulière dans le paysage poétique français. Une voix qui ne cherche pas la séduction facile, qui ne cultive pas l’originalité pour l’originalité, mais qui creuse patiemment son sillon. Une voix qui a compris que la vraie nouveauté ne consiste pas à inventer des formes extravagantes, mais à regarder le monde d’une manière neuve.
Informations éditoriales :
- Titre complet : Primaires
- Auteur : Léo Poirier
- Éditeur : Les Bonnes Feuilles – Site de l’éditeur
- Format : Broché, environ 75 pages
- Prix : 15,80€ (prix indicatif)
À propos des éditions Les Bonnes Feuilles :
Lancées en 2025 dans la continuité des éditions Poésie.io, Les Bonnes Feuilles sont une maison d’édition parisienne qui « réinvente l’édition pour faire émerger de nouveaux auteurs ». Se définissant comme « Sensible. Moderne. Puissante », cette jeune maison privilégie les voix singulières et l’exigence littéraire. Elle organise notamment un Prix des lecteurs mensuel permettant au public de soutenir directement les auteurs publiés, et anime une communauté de plus de 29 000 abonnés sur Instagram. Implantée au 11 rue Alexandre Dumas dans le 11e arrondissement de Paris, Les Bonnes Feuilles incarnent un nouvel âge de l’édition indépendante, numérique dans ses outils de diffusion, mais fidèle à l’exigence littéraire classique dans ses choix éditoriaux.
Pour commander cet ouvrage : directement sur le site des éditions Les Bonnes Feuilles