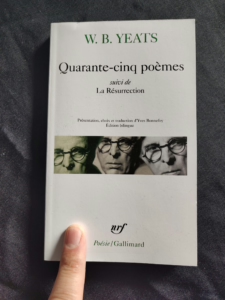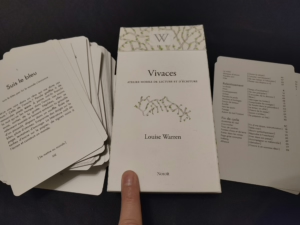Il y a des œuvres poétiques qui possèdent ce pouvoir singulier de transformer notre rapport au réel. Elles ne nous offrent pas seulement de belles images ou des émotions esthétiques ; elles refondent notre manière de voir, de sentir, de penser le monde. Le Gardeur de troupeaux de Fernando Pessoa, publié sous l’hétéronyme d’Alberto Caeiro, appartient à cette catégorie. Ce recueil, composé dans un élan fulgurant en mars 1914, inaugure l’un des phénomènes les plus stupéfiants de la littérature moderne, celle de la création par Pessoa d’une constellation d’écrivains fictifs, chacun doté de sa biographie, de son style, de sa philosophie propre. Alberto Caeiro, le berger philosophe qui refuse toute métaphysique au nom d’un sensualisme radical, devint le « maître » des autres hétéronymes pessoens,Álvaro de Campos, Ricardo Reis, et Pessoa lui-même. Cette édition établie par Armand Guibert offre au lecteur francophone l’accès à cette parole essentielle, complétée par les poésies d’Álvaro de Campos. Nous voici face à une œuvre paradoxale : une philosophie du non-penser, une sagesse de l’immédiateté, un mysticisme de la surface. Pessoa, par la bouche de Caeiro, nous invite à désapprendre nos habitudes mentales, à voir les choses telles qu’elles sont, sans projections symboliques ni constructions intellectuelles. Cette ascèse radicale du regard constitue peut-être l’une des tentatives les plus audacieuses de la modernité pour retrouver l’innocence perceptive.
La couverture de cette édition Gallimard frappe d’abord par sa rigueur classique. Sur fond blanc immaculé, le nom de l’auteur s’affiche en capitales d’un bleu profond « FERNANDO PESSOA », ancrant d’emblée l’ouvrage dans l’identité de son créateur réel plutôt que dans celle de l’hétéronyme. Ce choix éditorial n’est pas anodin, il rappelle que derrière la multiplicité des voix se tient un seul homme, un seul génie poétique capable de ventriloquie littéraire.
Le titre, Le Gardeur de troupeaux, s’inscrit en caractères noirs élégants, évoquant immédiatement une figure pastorale, archaïque, presque biblique. La mention « et les autres poèmes d’Alberto Caeiro avec Poésies d’Álvaro de Campos » annonce la richesse du volume, nous ne lirons pas seulement l’œuvre fondatrice de Caeiro, mais découvrirons aussi la voix moderniste et violente de Campos. L’indication « Préface et traduction d’Armand Guibert » garantit le sérieux philologique de l’entreprise.
Au centre de la couverture, une photographie saisit le regard. Un visage émerge d’un fond grisâtre, presque brumeux. Fernando Pessoa nous fixe avec une intensité troublante; moustache fine, regard perçant sous un chapeau sombre, traits fins et ascétiques. Cette image, datant probablement des années 1910-1920, capture quelque chose d’essentiel : la solitude, l’intériorité extrême, le mystère d’un homme qui contenait des mondes. Le cadrage serré, presque cinématographique, crée une intimité paradoxale. Nous regardons un visage, mais ce visage semble déjà nous échapper, se dissoudre dans le flou qui l’entoure.
Le choix de cette photographie énigmatique dialogue subtilement avec le projet poétique de Caeiro. Ce dernier prône un regard direct sur les choses, sans intermédiaire symbolique ; mais la photographie, elle, capture justement cette impossibilité, le visage est là, présent, et pourtant déjà fantomatique, déjà multiple. Pessoa photographié est déjà Caeiro, Campos, Reis, tous à la fois et aucun en particulier. L’objet-livre devient ainsi le sarcophage élégant d’une œuvre hantée par la question de l’identité et du dédoublement.
L’homme orchestre de la littérature portugaise
Fernando António Nogueira Pessoa naquit à Lisbonne le 13 juin 1888, dans une famille de la petite bourgeoisie portugaise. Son enfance fut marquée par deux deuils précoces : la mort de son père en 1893, puis celle de son jeune frère en 1894. Sa mère se remaria avec un diplomate portugais en poste à Durban, en Afrique du Sud, où la famille s’installa. Pessoa, adolescent, reçut donc une éducation britannique, se formant à la littérature anglaise, Shakespeare, Milton, Keats, Browning, qui marqua profondément son imaginaire. Parfaitement bilingue, il écrivit une partie de son œuvre directement en anglais.
De retour à Lisbonne en 1905, Pessoa entreprit des études commerciales qu’il abandonna rapidement. Il gagna sa vie comme traducteur et correspondancier commercial pour diverses entreprises, menant une existence modeste et solitaire. Célibataire endurci, vivant dans des pensions et des chambres meublées, il passait ses soirées dans les cafés littéraires de Lisbonne, écrivant sans relâche. Physiquement fragile, myope, portant invariablement costume sombre et chapeau, il cultivait une apparence austère qui contrastait avec l’effervescence intérieure de son génie.
L’événement capital de sa vie littéraire survint le 8 mars 1914. Dans une lettre célèbre à son ami Adolfo Casais Monteiro, Pessoa raconte cette journée « triomphale » où naquirent les hétéronymes. Debout devant sa commode, il écrivit d’un trait trente et quelques poèmes, Le Gardeur de troupeaux était né, signé Alberto Caeiro. Immédiatement, deux autres figures émergèrent, Ricardo Reis, le poète néoclassique partisan des odes horaciennes, et Álvaro de Campos, le moderniste futuriste aux exclamations véhémentes. Ces hétéronymes ne furent pas de simples pseudonymes, Pessoa leur inventa une biographie complète, un physique, un caractère, une philosophie. Caeiro naquit ainsi à Lisbonne en 1889, vécut dans un village de la campagne portugaise, mourut jeune de la tuberculose, ayant à peine reçu d’éducation formelle. Reis fut diplomate monarchiste exilé au Brésil, helléniste et épicurien. Campos étudia l’ingénierie navale en Écosse, voyagea en Orient, connut l’ennui métaphysique des grandes villes modernes.
Cette multiplication hétéronymique n’était pas caprice littéraire mais nécessité ontologique. Pessoa se sentait habité par des voix multiples, irréconciliables. Plutôt que de les réduire à une synthèse factice, il leur donna existence autonome. Chaque hétéronyme incarna une possibilité de son être, une facette de sa personnalité éclatée. Caeiro devint le « maître », celui qui enseigne la simplicité du regard ; Reis, le disciple classique qui cherche l’ataraxie stoïcienne ; Campos, le disciple rebelle qui oscille entre exaltation futuriste et dépression existentielle. Pessoa « lui-même » qu’il nomma parfois l’« orthoétéronyme » occupa une position ambiguë, tiraillé entre ces voix contradictoires.
Pessoa publia peu de son vivant. Quelques poèmes dans des revues littéraires, un recueil en anglais (Antinous, 1918), et surtout Message (1934), son unique livre publié en portugais, recueil de poèmes patriotiques sur l’histoire du Portugal. Il dirigea des revues éphémères, participa aux cercles modernistes lisboètes, mais demeura largement inconnu du grand public. Le 30 novembre 1935, à quarante-sept ans, il mourut d’une cirrhose dans un hôpital de Lisbonne. Ses derniers mots, griffonnés en anglais sur un bout de papier « I know not what tomorrow will bring. »
Après sa mort, on découvrit dans sa chambre une malle contenant plus de vingt-cinq mille documents manuscrits : poèmes, fragments, projets, écrits en portugais, en anglais, en français. Cette œuvre immense, désordonnée, hétéroclite, fut progressivement éditée au fil des décennies. Pessoa devint alors ce qu’il n’avait jamais été de son vivant : l’une des figures majeures de la poésie mondiale du XXe siècle, le Shakespeare portugais, le Whitman de l’Europe. Sa postérité fut d’autant plus éclatante qu’elle avait été retardée. Aujourd’hui, statues et plaques commémoratives parsèment Lisbonne, et sa maison natale abrite un musée. Le solitaire est devenu gloire nationale.
Une éloge de la vision innocente
Ouvrir Le Gardeur de troupeaux, c’est entrer dans un univers poétique d’une simplicité trompeuse. Les quarante-neuf poèmes qui composent le recueil semblent d’abord limpides, presque naïfs. Caeiro parle des fleurs, des arbres, des nuages, du soleil. Il se présente comme un berger rustique, « gardeur de troupeaux », vivant au rythme des saisons dans une campagne indéterminée. Pas de grandes envolées lyriques, pas de métaphores alambiquées. La langue est dépouillée, presque prosaïque. Les vers libres s’enchaînent sans souci de la rime ou de la métrique classique. Tout semble respirer une évidence tranquille.
Mais cette simplicité apparente dissimule une radicalité philosophique stupéfiante. Dès le premier poème, Caeiro énonce son crédo « Je n’ai pas de philosophie : j’ai des sens… » Il rejette d’emblée toute spéculation métaphysique, toute recherche de sens caché derrière les phénomènes. Les choses sont ce qu’elles sont, un point c’est tout. Une fleur n’est qu’une fleur, sans symbolique, sans signification transcendante. Le ciel bleu est bleu, la pierre est dure, l’eau coule. Caeiro se veut pur regard, pure sensation, débarrassé de tout appareil conceptuel.
Cette philosophie du sensualisme absolu s’oppose frontalement à toute la tradition métaphysique occidentale, de Platon aux idéalistes allemands. Pour Caeiro, penser c’est déjà trahir le réel, c’est interposer entre nous et les choses le voile opaque des idées. Il faut désapprendre, redevenir enfant, retrouver cet état d’innocence perceptive où les sensations nous atteignent directement, avant toute élaboration intellectuelle. Le berger philosophe se fait ainsi anti-philosophe, prônant une sagesse de l’immédiateté.
Le rythme des poèmes mime cette simplicité voulue. Les vers sont courts, les images concrètes. Caeiro décrit ce qu’il voit : « Le Tage est plus beau que le fleuve qui coule dans ma ville, Mais le Tage n’est pas plus beau que le fleuve qui coule dans ma ville Parce que le Tage n’est pas le fleuve qui coule dans ma ville. » Cette tautologie apparente énonce en réalité une vérité essentielle, chaque chose possède sa singularité irréductible, son unicité. Comparer, hiérarchiser, c’est déjà abstraire, donc perdre le contact avec le réel.
L’ironie souriante traverse néanmoins le recueil. Caeiro se moque gentiment des « chercheurs de vérité », des métaphysiciens qui s’épuisent à résoudre des énigmes inexistantes « Le mystère des choses ? Quel mystère ? Le seul mystère c’est qu’il y ait quelqu’un qui pense au mystère. » Cette déconstruction du mystère métaphysique rejoint les intuitions du positivisme logique et de la philosophie analytique, mais formulée avec une légèreté poétique qui n’appartient qu’à Caeiro.
Les saisons structurent discrètement le recueil. Caeiro chante le printemps, l’été, l’automne, l’hiver, sans nostalgie ni mélancolie. Chaque saison est parfaite en soi, accomplissement d’un cycle naturel. Pas de regret du temps qui passe, le temps ne passe pas, il se renouvelle. Cette sagesse cyclique, orientale presque, trouve sa formulation la plus pure dans le célèbre poème IX : « Je suis un gardeur de troupeaux. Le troupeau c’est mes pensées Et mes pensées sont toutes des sensations. » Magnifique renversement, le berger garde non des moutons mais ses propres perceptions, qu’il laisse paître librement dans le pré de la conscience.
La nature chez Caeiro n’est jamais sublime, majestueuse, écrasante. Elle est familière, quotidienne, presque domestique. Les arbres sont des compagnons, les fleurs des amies, les nuages des passants. Cette intimité avec le monde naturel traduit l’abolition de la distance sujet-objet. Caeiro ne contemple pas la nature de l’extérieur : il en fait partie, il est nature. Cette dissolution panthéiste du moi dans le cosmos s’opère sans emphase mystique, dans l’évidence tranquille du quotidien.
Les Poésies d’Álvaro de Campos qui complètent le volume offrent un contraste saisissant. Campos, l’ingénieur moderniste, rejette la sérénité de Caeiro pour un lyrisme véhément, exclamatif, souvent désespéré. Son célèbre « Ode maritime » chante la machine, la vitesse, l’ivresse futuriste, avant de sombrer dans la nausée existentielle. « Tabacaria » médite devant un bureau de tabac sur l’échec de toute ambition, l’impossibilité d’être « quelque chose ». Si Caeiro incarne la plénitude sensible, Campos exprime la crise moderne, la conscience malheureuse de l’homme coupé de l’être. Cette juxtaposition permet au lecteur de mesurer l’amplitude du génie pessoén, sa capacité à habiter des tonalités radicalement opposées.
Métaphysique du regard et philosophie de l’instant
Derrière l’apparente simplicité de Caeiro se cache une pensée philosophique cohérente et radicale. Son sensualisme n’est pas empirisme naïf, mais ascèse spirituelle. Il s’agit de décaper le regard de toutes les scories accumulées par la culture, l’éducation, l’habitude. Voir vraiment exige un effort immense, car nous ne voyons généralement pas les choses mais nos représentations des choses. Le langage lui-même déforme la perception : nommer, c’est déjà catégoriser, subsumer le singulier sous l’universel.
Cette critique du langage et de la pensée conceptuelle rapproche Caeiro du nominalisme radical de certains mystiques, mais aussi de la phénoménologie husserlienne et de son appel au « retour aux choses mêmes ». Edmund Husserl, contemporain de Pessoa, cherchait précisément à suspendre nos préjugés pour atteindre les phénomènes dans leur donation originaire. Caeiro, à sa manière poétique, pratique cette épokhè, cette mise entre parenthèses du jugement, pour accéder à la pure présence sensible.
Le refus de la métaphysique chez Caeiro s’enracine dans une intuition fondamentale : l’être n’est pas caché derrière les apparences, il est les apparences. Pas d’essence secrète à découvrir, pas de monde nouménal distinct du monde phénoménal. Cette position phénoméniste rejoint certaines traditions orientales, bouddhisme zen, taoïsme, qui affirment que « le vide est forme, la forme est vide ». Caeiro aurait pu signer le célèbre kōan zen : « Avant l’illumination, couper du bois, porter de l’eau ; après l’illumination, couper du bois, porter de l’eau. » L’éveil spirituel ne change rien au monde, il change notre manière de le voir.
Cette philosophie comporte néanmoins une ambiguïté. Caeiro prétend ne pas penser, mais ses poèmes sont saturés de pensée. Affirmer « je ne pense pas » est déjà penser. Déclarer « il n’y a pas de mystère » formule une thèse métaphysique. Pessoa était parfaitement conscient de ce paradoxe. Caeiro incarne un idéal impossible : celui d’une conscience sans réflexivité, d’un regard pur non médiatisé par le langage. Cet idéal, inatteignable pour l’homme, fait de Caeiro moins un modèle réaliste qu’un horizon régulateur, une limite asymptotique vers laquelle tendre sans jamais l’atteindre.
La question du temps traverse souterrainement l’œuvre. Caeiro vit dans un présent perpétuel. Pas de nostalgie du passé, pas d’angoisse du futur. Chaque instant suffit pleinement. Cette temporalité de l’immédiateté s’oppose à la conscience historique moderne, obsédée par la durée, la continuité, le progrès. Caeiro retrouve l’instant éternel des Anciens, ce nunc stans où le temps s’abolit dans la plénitude de la présence. On pense à l’ekstasis des mystiques, mais vidé de toute transcendance : l’extase de Caeiro est immanente, terrestre, sensuelle.
La nature chez Caeiro n’est pas symbolique. C’est là sa plus grande originalité dans le contexte du symbolisme dominant. Où Baudelaire voyait dans la nature une « forêt de symboles », où Mallarmé cherchait à transmuer le réel en Idée, Caeiro affirme l’autosuffisance des choses. Une fleur ne renvoie à rien d’autre qu’à elle-même. Cette désymbolisation radicale annonce certaines démarches contemporaines, minimalisme, art conceptuel, qui refusent l’interprétation herméneutique au profit de la pure présence matérielle.
Enfin, la figure du berger mérite attention. Caeiro choisit l’une des plus anciennes figures de la tradition pastorale : le pâtre contemplant son troupeau. Mais il subvertit l’archétype. Chez Virgile ou Théocrite, le berger est poète cultivé déguisé en rustique. Caeiro inverse le mouvement, c’est le citadin cultivé qui se déguise en berger inculte pour retrouver l’innocence perdue. Ce berger ne joue pas de flûte, ne chante pas d’églogues amoureuses. Il se contente d’être là, présent au monde, sans projet ni désir. Sa sagesse tient dans cette passivité active, cette disponibilité sans attente.
En conclusion
Que nous dit Caeiro en ce XXIe siècle saturé d’images et d’informations ? Beaucoup, peut-être plus que jamais. Son appel à voir vraiment résonne dans notre époque d’écrans omniprésents, où nos perceptions sont constamment médiatisées, filtrées, algorithmiquement triées. Retrouver le contact direct avec le réel, sentir la texture des choses, respirer l’air non conditionné : autant d’exercices spirituels d’une urgence renouvelée.
Cette édition bilingue offre un accès privilégié à l’univers pessoén. La traduction d’Armand Guibert, sobre et fidèle, restitue la simplicité voulue de Caeiro sans trahir la subtilité philosophique. Le lecteur peut comparer l’original portugais et la version française, mesurer les écarts et les réussites de la transposition. La préface éclaire le contexte biographique et littéraire, permettant de situer l’œuvre dans la constellation hétéronymique.
Ce volume s’adresse à plusieurs publics. Les amateurs de poésie découvriront une voix singulière, débarrassée de toute affectation lyrique. Les philosophes trouveront matière à réflexion sur la perception, le langage, l’être. Les chercheurs de sagesse reconnaîtront dans Caeiro un maître spirituel paradoxal, enseignant le non-enseignement. Les portugisants apprécieront la finesse de la langue pessoénne, sa capacité à faire de la prose philosophique une musique poétique.
Le Gardeur de troupeaux n’est pas lecture facile, malgré les apparences. Sa simplicité exige du lecteur qu’il suspende ses habitudes interprétatives, qu’il renonce à chercher du sens caché. Lire Caeiro suppose accepter que parfois, une fleur n’est qu’une fleur. Cette ascèse herméneutique déroute, frustre même. Mais elle ouvre aussi une liberté : celle de contempler le monde sans projeter constamment nos désirs et nos peurs. Dans notre époque où tout doit signifier, où rien ne peut rester opaque, Caeiro rappelle la dignité du non-sens, la beauté de ce qui est simplement là.
Informations éditoriales :
- Titre complet : Le Gardeur de troupeaux et les autres poèmes d’Alberto Caeiro avec Poésies d’Álvaro de Campos
- Auteur : Fernando Pessoa (1888-1935) / Hétéronymes : Alberto Caeiro et Álvaro de Campos
- Éditeur : Gallimard, collection Poésie/NRF – Site de l’éditeur
- Préface et traduction : Armand Guibert
- Année de publication : 1987 (réédition)
- Nombre de pages : 273 pages
Pour commander cet ouvrage : La Librairie